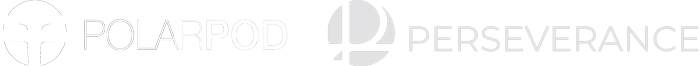SOMMAIRE

UNE COUCHE DE GLACE À LA SURFACE DE LA MER
En fin d’été, le froid polaire s’installe, parfois brutalement (–40°C); la surface de l’océan se refroidit. Quand elle atteint –1,8°C, les premiers cristaux de glace se forment. Une fois la surface gelée, l’eau de mer se trouve isolée de l’air froid et le processus se ralentit. La banquise s’épaissit alors lentement, par sa face inférieure, jusqu’à atteindre environ 2 mètres.
DOUCE OU SALÉE ?
En gelant, l’eau de mer forme une imbrication de cristaux de glace d’eau douce et de gouttelettes de saumure. Durant l’hiver, ces gouttelettes salées se regroupent, dessinent des réseaux plus larges, puis des poches, et migrent vers le bas, avant d’être rejetées en mer. Ainsi, en vieillissant, la banquise s’adoucit.
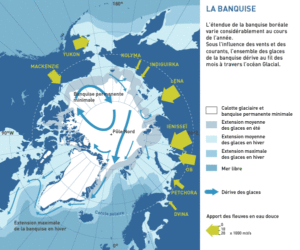
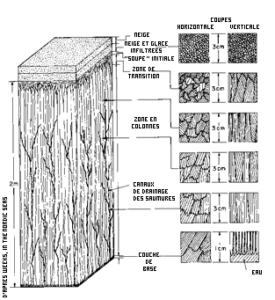
AINSI VIT LA BANQUISE
Au coeur de l’hiver, la banquise s’étend sur près de 15 millions de km2, dont près de la moitié fondra durant l’été. La partie restante persistera 2, 3, 4 ans ou plus et son épaisseur atteindra alors 4 à 5 mètres. Pendant ce temps, cette croûte de glace traversera l’Océan Glacial, emportée par les courants : c’est la dérive arctique.
UN RADEAU CHAOTIQUE
La banquise n’est qu’une fine coquille d’œuf comparée aux 4000 mètres d’eau sur lesquels elle flotte ! Emportée par les courants, harcelée par les vents, sans cesse elle se brise, s’ouvre, se chevauche, créant, ici, des chenaux d’eau libre, là des rides de glace dont la crête peut atteindre une dizaine de mètres de haut.
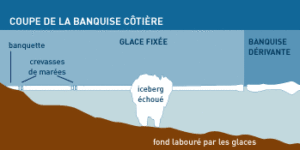
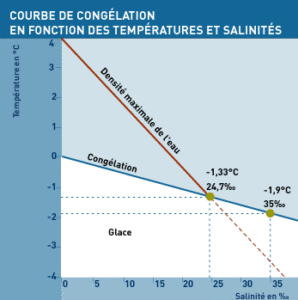
LE DÉBUT DE LA PRISE
La nature de la première glace dépend de l’état de la mer. Par temps calme, de grands cristaux en forme d’aiguilles s’orientent parallèlement et forment une couche de 1 à 2 cm d’épaisseur en surface (une ” soupe ” glacée). Si la mer est agitée, de petits cristaux se développent en tout sens sur parfois un mètre de profondeur, constituant une épaisse couche visqueuse : le frasil. C’est ensuite seulement, que la congélation commence en surface. Cette prise peut durer de 9 à 36 jours.
QUAND LA GLACE S’ÉPAISSIT
Tant que la glace est fine, houle et vents la fragmentent en ” crêpes “, qui finissent par se souder et former la jeune banquise, capable alors de retenir la neige. Il faut plusieurs semaines pour que la glace atteigne 60 cm d’épaisseur. En chassant lentement bulles d’air et saumures, la glace se compacte, s’adoucit, devient bleue et translucide.

L’ Antarctica pris dans les glaces au Spitzberg. © F. Latreille/7eme Continent
AU CŒUR DE LA GLACE
En arctique, la salinité de la mer varie en surface de 32 à 33 g/L (contre 35 en moyenne pour l’océan mondial). Les premiers cristaux de glace forment de petites lamelles d’1 millimètre d’épaisseur et d’infimes gouttelettes de saumure (une dizaine de micromètres) sont piégées dans ce réseau cristallin. La jeune glace de mer emprisonne ainsi jusqu’à 22 g/L de sels. L’eau de mer contient également des impuretés et des bulles d’air, piégées aussi dans la glace.

UNE AGITATION PERMANENTE
Sous l’effet des vents, des courants, des marées, la banquise se fragmente et se reforme sans cesse. Ici, des chenaux d’eau libre s’ouvrent, ainsi que des sortes de lacs intérieurs (polynies) dus à des remontées locales d’eau moins froide. Là, les fissures se referment.
Les collisions entre les fragments créent des rides de glace comprimée, dont la crête peut atteindre 10 mètres et la quille s’enfoncer jusqu’à une soixantaine de mètres !
Près des côtes, la banquise est aussi façonnée par les marées, les apports d’eau douce, les courants littoraux, l’exposition au vent ou au soleil. Une banquette de glace, posée sur le fond, reste attachée à la côte. Cette “glace riveraine” peut être plus épaisse que la banquise elle-même et s’ancrer au fond ; au large, elle se prolonge par une bande de “glace fixée” (en anglais fast ice), qui peut survivre plus de 10 ans. On y trouve parfois quelques icebergs prisonniers.
LORSQUE VIENT LA FONTE
Fin mai, la neige et les premiers centimètres de glace fondent, formant des mares à la surface de la banquise. Cette eau réfléchit moins l’énergie solaire que la glace nue et se réchauffe plus vite, accélérant localement la fonte. Lorsque la banquise se fracture, de grands pans se libèrent (floes) puis se déplacent au gré des courants C’est la débâcle. Au centre de l’océan Arctique et le long des côtes abritées, la banquise ne dégèlera pas.
LE GRAND BALLET DE LA DÉRIVE ARCTIQUE
Le puzzle glacé de l’océan Arctique suit, au fil des mois, le mouvement général des eaux qui le portent. C’est la dérive arctique.
La banquise se déplace selon deux courants principaux : une large boucle cyclonique, centrée vers 80° N–155° W et une longue dérive qui traverse l’océan, du détroit de Béring à la côte groenlandaise. En moyenne, la glace peut tourner 5 ans dans la boucle arctique, tandis qu’un bloc mettra environ 3 ans pour suivre le courant central trans-arctique.
La dérive arctique a été découverte grâce aux débris de l’épave de La Jeannette (1881) retrouvés 3 ans plus tard à des milliers de kilomètres du lieu de naufrage. Nansen avec le Fram en 1893-1896 et Papanine en 1937 ont utilisé cette dérive.
ÉTUDIER LA BANQUISE
Chenaux, crêtes de compression, glaces de salinité et d’âges différents, pulsation saisonnière, dérive : toute la vie de la banquise est suivie par les scientifiques grâce aux stations dérivantes installées sur la glace, aux balises et aux satellites.
NAVIGUER DANS LA BANQUISE
LE COIN DES PHYSICIENS
UN PEU DE VOCABULAIRE

Jean-Louis Etienne tirant son traîneau sur la banquise lors de sa marche en solitaire vers le Pôle en 1986. © B. Prudhomme