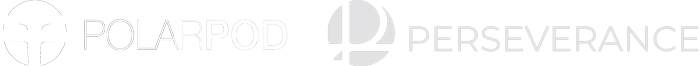SOMMAIRE
CALOTTES POLAIRES ET GLACIERS : DES PIÈGES À EAU DOUCE
Lorsque la neige ne fond pas durant l’été, elle s’accumule, se tasse et, couche après couche au fil des ans, se transforme en glace. Pendant longtemps, cette eau ne retournera plus à la mer. Ainsi se forment les immenses et épaisses calottes glaciaires continentales – ou inlandsis – comme celles qui recouvrent actuellement l’Antarctique et le Groenland.
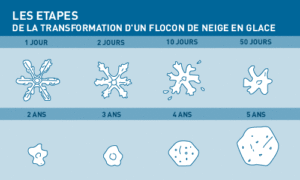
DES FLEUVES DE GLACE
Un glacier est une sorte de rivière gelée, accrochée aux montagnes. Sous son propre poids, l’énorme masse blanche s’écoule lentement, creusant sa vallée. Ce mouvement, bien qu’imperceptible à nos yeux, arrache des blocs de roches au lit du glacier, qui, en avançant – ou en fondant à son front – dépose son fardeau en longs amoncellements de pierres : les moraines.
LES ICEBERGS : QUAND LA GLACE D’EAU DOUCE RETOURNE À LA MER
Lorsqu’un glacier arrive en bord de mer, la langue de glace, poussée par l’écoulement, commence à flotter, puis se brise : des blocs se détachent et sont emportés par l’océan ; on dit que le glacier vêle. Ces îlots de glace d’eau douce, les icebergs, restent parfois piégés par la banquise. Ils transportent les roches arrachées à leur lieu d’origine, qu’ils sèment, en fondant, au fond de l’océan.
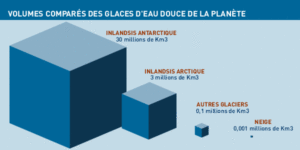
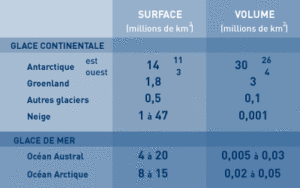
DES CONTINENTS QUI SOMBRENT SOUS LE POIDS DES CALOTTES
Au cours du Quaternaire, de lourdes calottes de glaces ont recouvert le Nord de l’Europe et de l’Amérique. Sous leur poids, les continents se sont enfoncés dans le manteau fluide de la Terre, comme un bateau que l’on charge. Ainsi aujourd’hui, libérées de leur fardeau, ces terres ” remontent ” encore progressivement !
LES INLANDSIS : UNE ÉPAISSE COUVERTURE DE GLACE POSÉE SUR LES CONTINENTS
Il existe aujourd’hui deux inlandsis (“glace de l’intérieur” en islandais). Au Sud, l’immense calotte antarctique recouvre un continent – en réalité, un archipel – de 14 millions de km2; au Nord, c’est le Groenland qui est dissimulé sous 1,8 millions de km2 de glace continentale.
La calotte groenlandaise, ancrée entre deux chaînes montagneuses côtières, peut dépasser 3 km d’épaisseur dans la cuvette continentale centrale. La glace formée au cœur de l’inlandsis met très longtemps à atteindre la mer ; on retrouve ainsi, en profondeur, une glace âgée de plusieurs dizaines de milliers d’années. Une aubaine pour étudier, conservées dans ces glaces, les caractéristiques des climats passés de la Terre.
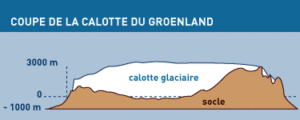
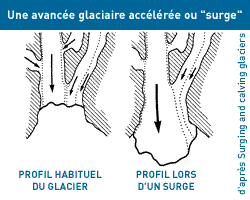
COMMENT SE SONT FORMÉES LES CALOTTES POLAIRES ?
Les scientifiques ont déduit de la chimie des glaces polaires que ces énormes calottes se sont accumulées en quelques milliers d’années. Il faut pour cela que les précipitations neigeuses aient été beaucoup plus importantes que ce que l’on peut observer aujourd’hui au-dessus de ces déserts glacés. Et pourtant, l’air froid y est sec et n’aurait pas dû permettre de telles chutes de neiges.
Pendant les dernières glaciations de l’hémisphère Nord, la température de l’océan était plus élevée qu’actuellement : d’un ou deux degrés. Cette différence a été suffisante pour que le gradient thermique entre l’océan “chaud” et le continent très froid provoque le développement de tempêtes de neige.
La calotte groenlandaise s’est formée, il y a environ 3 millions d’années, lorsque le climat s’est refroidi (depuis, il y a eu plus de 25 poussées glaciaires…). Sous le poids de la glace, le continent s’est enfoncé de près d’un kilomètre dans le manteau de la Terre, se transformant en une large cuvette.
SOUS L’ÉPAISSE CALOTTE, LE FROID DE LA DERNIÈRE GLACIATION
C’est la température à la base de la calotte qui contrôle l’écoulement de la glace. Mais les variations de températures en surface n’atteignent la base qu’amorties et au bout d’un temps très long. Ainsi, il faut 60 ans pour qu’un changement de température de surface atteigne 100 m de profondeur et 60 000 ans pour qu’elle atteigne 3 100 m. On peut donc penser qu’à la base d’un inlandsis actuel règne encore le froid du dernier âge glaciaire.
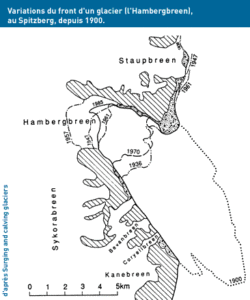
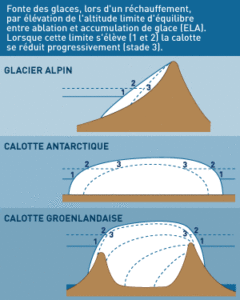
VÊLAGE DES GLACIERS : LA NAISSANCE DES ICEBERGS
Lorsque la glace se rapproche de la côte, elle est canalisée par les glaciers littoraux et sa vitesse d’écoulement s’accélère : elle peut atteindre plusieurs mètres par jour. Une fois en mer, plus légère que l’eau, la langue glaciaire se détache de son lit rocheux et se met à flotter. Travaillés par la houle, les courants, les marées et poussée par son propre écoulement, des blocs s’écroulent dans la mer dans un bruit de tonnerre : ainsi naissent les icebergs, ces “montagnes de glace”.
GLACIERS POLAIRES SOUS SURVEILLANCE
À cause de l’exploration des fonds de la mer de Barents pour l’éventuelle exploitation des réserves de pétrole et de gaz sous-marines, les rejets d’icebergs par les glaciers du Svalbard (vêlage) ont été particulièrement étudiés. En effet, plusieurs d’entre eux sont dangereux pour les installations off-shore ; en particulier, lorsque se produit un phénomène d’”avancée accélérée”, ou surge.
Le déclenchement de ces vêlages intensifs est encore mal compris et leurs périodes – propres à chaque glacier – mal connues ; ce qui est un sérieux handicap lorsqu’on tente d’apprécier les bilans des calottes polaires actuelles, ou encore de prévoir leur réponse à un éventuel changement climatique.
Au total, sur 90 glaciers vêlant en mer étudiés, 55 surges ont été enregistrés au cours des 100 ou 150 dernières années, sans que l’on puisse en déterminer les rythmes. Mais au moins, la liste des glaciers “livreurs d’icebergs” potentiels a-t-elle pu être dressée.
Lors d’un surge, toujours brusque, de larges champs de crevasses apparaissent, le front se bombe, les moraines s’incurvent, le débit de la langue glaciaire s’accroît considérablement. Une énorme quantité de glace d’altitude se trouve alors rejetée vers le bas, provoquant une accélération dramatique de l’avancée du front (l’écoulement peut atteindre 100 mètres par jour, auto-lubrifié par la fonte due aux frottements). En temps normal, à l’équilibre, autant de glace est ôtée à un glacier par ablation qu’il ne s’en forme en altitude par précipitation. Mais l’avancée accélérée crée un fort déséquilibre, amincissant nettement le glacier.
La période de ces phénomènes peut aller de 30 à 100 voire 150 ans, le surge lui-même dure 1 à 3 ans. Ces “emballements” sont beaucoup plus fréquents en régions subpolaires, où parties froides et plus tempérées d’un même glacier sont mitoyennes.
Les avancées glaciaires accélérées les plus impressionnantes ont eu lieu au Svalbard au cours des années 1935-38 : le Negribreen, au fond du Storfjord, a avancé à ce moment-là de 12 km dans son fjord et le Bråsvellbreen, émissaire de la calotte de la terre du Nord-Est, de 20 km en mer !
ICEBERGS : DES MONTAGNES DE GLACE À LA DÉRIVE
Outre la banquise, l’océan Arctique transporte des icebergs.
On peut reconnaître l’origine de ces énormes glaçons à leur forme. Les icebergs de glaciers étroits et épais comme ceux des îles ou du Groenland sont massifs et hauts, alors que ceux qui proviennent de la plate Terre d’Ellesmer sont tabulaires. Ces icebergs plats, qui peuvent atteindre plusieurs km2, sont d’ailleurs utilisés comme stations dérivantes par les scientifiques.
Ils sont parfois pris dans la banquise et dérivent vers l’Atlantique Nord. Burinés par le vent et les vagues, 400 icebergs atteignent ainsi, en moyenne, le 48ème parallèle, au large de Terre-Neuve.
Pour éviter les accidents, en hiver, les routes maritimes sont repoussées de plusieurs centaines de kilomètres vers le sud. Chacun connaît l’histoire dramatique du Titanic …